
Retour sur la cérémonie du 27 Juin
Le 27 Juin dernier s'est tenue la table ronde marquant la clôture de l'année pour la promotion 2024-5 du DU Delphine Lévy, réunissant participantes et participants pour échanger autour de leurs travaux menés au long de l'année. Cette journée a permis nombre d'échanges et de réflexions enrichissants sur les perspectives autour des questions de l'accès au patrimoine culturel dans son sens le plus large.
Nous remercions tous les participantes et participants pour leur engagement et leur contribution à cette journée !
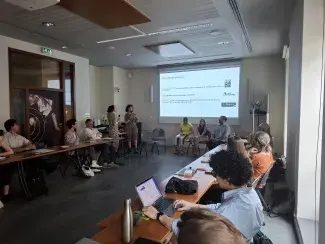
Table-ronde des partenaires
Sous la modération de Sophie Cras (co-directrice de la Chaire Delphine Lévy, MCF à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à gauche)
Cette table-ronde des partenaires a rassemblé les institutions avec lesquelles le DU collabore depuis sa création (ou presque). Par le retour d'expériences, elle a permis de réfléchir à la façon dont ce programme, qui a un positionnement singulier entre entre institutions culturelles et universités, entre recherche et pratique. peut s’inscrire dans un projet d’institution, alimenter des discussions, accompagner des transitions…
De gauche à droite
Alexandra Bosc (adjointe à la direction de la recherche et des collections, Paris Musées)
Sarah Galer (adjointe à la direction du service de la médiation humaine, en charge de l’unité Éducation, social et accessibilité, Musée du Louvre)
Philippe Rivière (directeur du numérique, Art Explora)
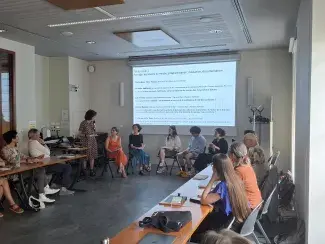
PARTAGER LES SAVOIRS AUX MUSEES
Sous la modération de Marie Frétigny (DU 2023-2024, Musée du Luxembourg, à gauche)
Cette première table-ronde porte sur un thème abordé chaque année, sous des angles toujours différents : la place des savoirs dans les institutions culturelles, les modalités de leur transmission et de leur « adresse » au public. Cette année, cette problématique a pris corps dans des réflexions concernant des échelles aussi variées que : la gestion de l'accès aux centres de documentation, la rédaction des cartels ou encore la mise en œuvre d'une programmation culturelle, de dispositifs de médiation dans un parcours d'exposition.
De gauche à droite
Blandine Smilansky, La micro-histoire au musée. Réflexions sur la transmission des savoirs dans l’exposition d’histoire
Jade Frezza, La programmation culturelle : un instrument au service de la redéfinition du rôle des institutions ?
Guillermo De La Torre Machorro, Le centre d’études et de documentation du département des Objets d’art du musée du Louvre. Pour une étude de cas sur l’accès aux savoirs et aux patrimoines au musée
Juliette Rannou, Les textes informatifs issus du réaménagement du parcours des collections permanentes du musée de la musique. Vers de nouvelles perspectives d’accès aux collections d’instruments de musique non européens ?
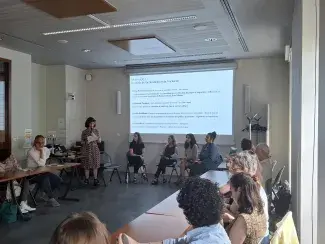
LES OUTILS DE L’ACCESSIBILITE ET DE L’INCLUSION
Sous la modération de Yaël Kreplak
Cette deuxième table-ronde touche à un autre sujet central dans le cadre du programme : comment œuvrer à une meilleure accessibilité et à davantage d’inclusion dans les institutions culturelles. Il s'agit d'une problématique transversale, que l'on retrouve également dans d'autres travaux, et qui continuera assurément à nourrir la réflexion dans les années à venir, les prochaines promotions.
Les travaux présentés ici ont pour particularité de proposer des outils – à la fois conceptuels et pratiques – avec une démarche qui, dans ces 4 cas, a consisté à partir de l’existant, à se nourrir d’autres façons de faire, d’autres réflexions, pour agir et mettre en place des dispositifs innovants.
De gauche à droite
Hélène Favrel, L’implémentation d’une démarche d’accessibilité universelle dans les projets d’exposition : réflexions et perspectives autour des projets du Palais Galliera, Paris Musées
Mélissande Preguiça, Inclusion des artistes en situation de handicap dans le secteur culturel
Ophélia Boukhana, L’impact du temps dans les programmes à destination des publics prioritaires : régularités et transitions
Sabrina Hervé, À l’hôpital, l’art comme présence : Pour une culture du soin et du lien
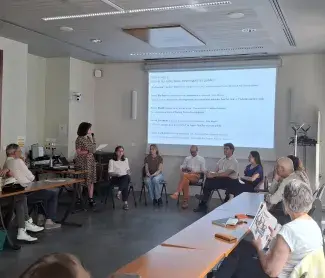
DIFFUSER LES COLLECTIONS, DEVELOPPER LES PUBLICS
Sous la modération de Charles Villeneuve de Janti (directeur des musées Gustave Moreau et Jean-Jacques Henner, au centre)
Cette troisième table-ronde touche à des questions un peu différentes, qui concernent d’une part la diffusion des collections, d’autre part le développement des publics. Il s'agit là de deux enjeux majeurs pour les institutions culturelles et pour les musées en particulier, qui ne vont pas sans soulever des enjeux certains : diffuser les collections, oui mais comment, à quels coûts, économiques, écologiques ; développer les publics : oui mais à quel prix, quels publics et pour offrir quelle expérience ?
De gauche à droite
Prune Blachère, Organisation et stratégies de développement des expositions muséales hors les murs à l’échelle internationale
Fanny Rioult, La numérisation haute définition, levier d’accessibilité ?
Steven Loveniers, Cahier des charges pour la création d’un espace familles et jeune public
Justine Cardoletti, Place et rôle des jeunes adultes au musée. L'exemple des Jeunes Amis de Musées

EXPERIENCES ET INNOVATIONS SENSORIELLES AU MUSEE
Sous la modération de Clara Royer (doctorante à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Histoire de l'Art, au centre)
Pour cette dernière table ronde, nous changeons quelque peu de régime d’analyse, avec des recherches qui s’attachent non pas seulement aux contenus, mais à la qualité – ou plutôt aux qualités – des expériences vécues dans les lieux d’exposition.
Ces travaux portent une attention fine à ce que l’on peut toucher, entendre, percevoir dans les musées : l’effet des couleurs des bâtiments et des murs, les ambiances, ou encore la manière dont les espaces peuvent se montrer plus ou moins accueillants, en favorisant des rythmes variés de déambulation, des zones de pause, des moments de respiration. Ils se distinguent par la combinaison d’un sens aigu de l’observation et d’une approche prospective, spéculative, voire exploratoire. Ce croisement méthodologique constitue un levier particulièrement fécond pour nourrir et faire progresser la réflexion.
De gauche à droite
Manon Béranger, L’utilisation de la couleur dans les musées, étude de ses effets sur les publics
Tali Schlanger, La matière en vitrine ; une étude du toucher dans les musées
Léa Dreyer, Médiations sonores dans les collections d'art visuel : la « résonance muséologique » par le son projeté. Un essai prospectif
Azad Huseynov Asifovich, La musée, la neuro-divergence et le handicap mental : création d’espace(s) inclusif(s) d’accueil et de détente pour les publics neuro-divergents et/ou en situation de handicap mental